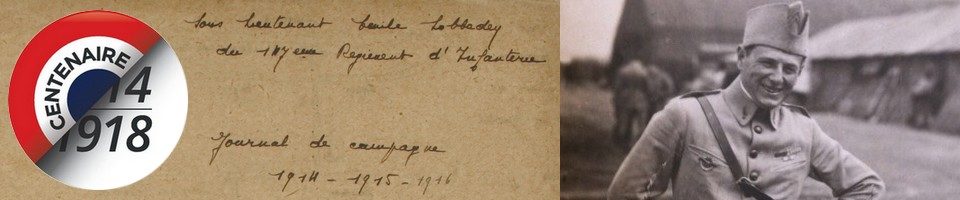Cantonnement dans Charmontois-l’Abbé
Nous sommes au bureau quand vers 9 heures Mascart s’amène et nous annonce, ô stupeur, que nous devrons déménager et nous installer, toute la 5e compagnie, à Charmontois-l’Abbé.
À Charmontois-le-Roi, dans notre cantonnement*, le génie vient s’installer ; à nous de décamper pour lui faire place. Tout ceci me regarde. Je cours trouver le capitaine. Il n’y a qu’à se soumettre. J’ai trois heures pour faire un nouveau cantonnement. La compagnie va recevoir les ordres de déménager à midi.
Je file donc à Charmontois-l’Abbé et me rends aussitôt voir l’adjudant de bataillon Gallois. Ce qu’il est mou, ce brave ami ! Enfin après bien des tergiversations, j’ai un cantonnement nettement délimité qui fut en partie inoccupé et dont l’autre moitié a été vidée des compagnies occupantes qui se sont resserrées. Cela demandait un quart d’heure et m’a pris une heure.
Je cours et trotte jusque midi. Mon cantonnement n’est pas fini car je me heurte à un tas de gens qui se disent chez eux, poilus* installés depuis l’arrivée et qui jugent bien ennuyeux de décamper.
Enfin j’ai quatre granges : les quatre sections sont donc logées, c’est un résultat. L’ennui pour les braves poilus est qu’ils ont quitté des granges aménagées par eux en salon, pour des granges chaumières ; tout est donc à recommencer, et cela malgré tout ne plaît pas outre mesure. J’eus une discussion avec un fermier qui ne voulait loger personne : je l’indique au capitaine qui dit l’avoir à l’œil.
Je ne mange pas, car j’ai mon métier à cœur. Je cherche des logements pour mes officiers. Après bien des ennuis, j’obtiens enfin une chambre dans une maison proprette. Deux sous-officiers y couchaient. Je les expulse sans plus de façon et loge les sous-lieutenants Alinat et d’Ornant.
Je pars à Charmontois-le-Roi, vois ces messieurs à table et déclare au capitaine qu’il n’y a certainement rien de potable pour lui. Très heureux de sa chambre ici, il décide de rester cantonné à Charmontois-le-Roi avec le docteur Veyrat son vis-à-vis et de garder également avec lui sa popote.
Il peut être une heure, je vais voir la famille Adam ; je vois Lannoy et lui dit que je cherche toujours et trouverai dussé-je mettre même les habitants hors de chez eux ; je suis bien « hors de moi ».
Je vois Jaquinot à qui je dis d’amener ce qui lui reste en magasin à l’autre village. Je vais chercher un magasin. Ce magasin je le trouve sans trop de mal dans une espèce d’atelier de menuiserie qui se trouve sur le bord de la route. J’ai pour cela une discussion épique avec une vieille catachrèse [1] ; menaces, larmes, insultes, rien n’y fait, je suis intransigeant. Jaquinot arrive avec sa voiture et s’installe tranquillement tandis que la vieille tournaille comme une panthère autour de lui.
Les sous-lieutenants s’amènent aussi et je leur indique leur logement. Je commence à respirer. Il est 2 heures et voici cinq heures que je suis en route. C’est à devenir fou quand il faut faire feu de tout et souvent de rien.
Reste l’installation d’un bureau et de notre petite popote*. Ici c’est du roman.
Je décide de tirer parti de la colère de la propriétaire de mon magasin qui se plaint amèrement d’avoir à loger. Je lui dis que tout le monde doit payer son écot [2]. Ce n’est pas long à venir, le renseignement discret. Elle me cite un tas de gens qui ne logent personne, me montre des maisons et en particulier la maison d’une vieille voisine ennemie qui se trouve en face. La maison est d’assez belle apparence ; je la croyais occupée par des hommes de la C.H.R.* « Détrompez-vous ; c’est la plus avare et la plus riche du village ; elle habite seule et ne veut jamais loger ». C’est tout ce que je devais savoir.
Je me rends donc aussitôt chez ma riche propriétaire. Je passe derrière l’habitation et pousse le loquet d’une porte. J’aperçois une cuisine de campagne spacieuse ; un très petit feu au fond. Je ne puis en voir plus. Une femme qui ressemble aux trois furies réunies s’est élancée comme une folle brandissant un balai et poussant des cris sauvages. Je me retrouve dehors, la porte au nez.
Ah, ah ! Il faudra faire un siège en règle. Je rentre donc à Charmontois-le-Roi. Je vais chez Adam et reviens bientôt avec les cuisiniers armés de leurs armes (les marmites) et une partie de notre bande.
« Vouloir, c’est pouvoir ». Il est près de 3 heures. À 4 heures, nous serons maitres de la place. Nous nous arrêtons non loin de la demeure et faisons colloque. Nous décidons que : je rentre et coûte que coûte et fais face à l’ennemi : tenir ou mourir, ne pas se replier.
Dix minutes après Culine qui a du talent pour se concilier les grâces des vieilles gens (rappelons-nous le père Louis et le père Thomas de Florent) entre à son tour. Il engage des pourparlers.
Une demi-heure après Levers et Delacensellerie, nos cuisiniers, arrivent s’installent bien tranquillement sans s’occuper de ce que l’ennemi leur dit.
Le reste de la bande ne fait irruption que sur le cri « Aux armes ».
Je fais un long détour et comme un bandit m’introduis furtivement dans la cuisine, fermant la porte rapidement derrière moi. J’y suis, j’y reste. La vieille femme a été surprise par mon intrusion. Quand elle se ressaisit, il est trop tard ; je suis assis sur une chaise basse près du misérable feu et engage la conversation. On me répond par des menaces, puis survient un flot de larmes. Je reste inébranlable. Il fait froid, je viens me chauffer et ne demande rien.
J’ai devant moi une misérable vieille recroquevillée sur elle-même, les mains sur quelques brindilles qui flambent à peine et un couvet [3] sous les jupes, à la mode d’autrefois. Cependant, mon succès s’accentue, car elle commence à parler du malheur des temps, des boches qui lors de l’invasion lui ont tout pris, de ses rhumatismes, de sa solitude. Je profite de ce mot pour faire un dithyrambe [4] sur le contact d’une popote de sous-officiers qui pour rien vous nourrit, vous chauffe et même à l’occasion vous indemnise.
Culine survient en se frottant les mains et criant « qu’il fait froid ». Il vient directement sur la brave vieille et lui tend la main en s’informant de sa santé. Il la plaint de toute son âme d’être ainsi seule et abandonnée, lui dit qu’il lui fera porter du bois et qu’il chargera ses cuisiniers de lui faire un bon thé au rhum bien chaud. La vieille ne réussit à placer un mot. Elle regarde mon camarade d’un air ahuri. Celui-ci déjà lui frappe sur l’épaule, lui demande son âge, lui jure ses grands dieux qu’elle paraît beaucoup plus jeune, qu’en la voyant il croit voir sa grand-mère qu’il aime tant et qu’il désespère de revoir, etc., etc.…
Sans façon il ouvre une porte qui donne dans une grande salle. La vieille s’élance sur lui. Il la prend dans ses bras, l’air peiné, et la reconduit à sa chaise, en la réprimandant de se mettre dans des états pareils qui lui font tort à sa santé.
J’engage la conversation avec Culine et tous deux nous déplorons le manque de popote dans la maison. « Madame serait si heureuse ». Culine se lève noble et fier et déclare qu’il veut le bien de celle qu’il considère comme une grand-mère. Malgré ses protestations ils veulent lui rendre service. Elle est seule, elle aura du monde. Elle n’a pas de bois, on lui en donnera. On la nourrira, on soignera ses rhumatismes. La brave femme ne sait si elle doit se juger heureuse ou non qu’on lui porte un tel intérêt. Elle n’a pas beaucoup le temps d’y songer. Nos cuisiniers arrivent ne pouvant s’empêcher de rire. Il est 3h30. L’action a été menée rapidement.
La brave femme mange une tartine beurrée que Levers lui a coupée incontinent et la forcée d’accepter, tandis que Delacensellerie fait du café. Et quand Lannoy rentre avec ses cahiers, il trouve la mère Azéline, c’est le nom de notre nouvelle propriétaire, en grande conversation avec nos deux cuisiniers à qui elle sourit car ils lui promettent le confort moderne.
Avec quelques difficultés, nous entrons dans la vaste pièce entrevue par Culine. Notre grand-mère nous recommande la propreté, le plus grand soin, un ordre sérieux, etc.… Etc.… On lui promet tout. Ce que nous voyons de plus clair, c’est que nous nous installons.
Et le soir tombe. Assis tranquillement, fumant ma cigarette, je me repose sur la position conquise, tandis que toute la bande arrivée un à un discrètement par intervalles se presse autour de la bonne maman et qu’un feu énorme monte dans le foyer.
Nos cuisiniers vaquent à leurs occupations comme si de rien n’était. Ils descendent les plats, décrochent les marmites de la maison, vont et viennent. Et quand la vieille élève une protestation, ils lui ordonnent de se chauffer et de ne s’occuper de rien. « À votre âge, on se laisse soigner » déclare noblement Levers.
Vers 5 heures je me rends chez le capitaine Aubrun pour lui rendre compte que tout est installé ; section, bureau, magasin etc.… Je rentre chez La Plotte où je trouve notre bande qui boit à la santé de la mère Azéline. Nous trouvons ici le chef de musique Legris accompagné d’un de mes amis, Girard de Paris, grand musicien. Madame a un violon et le chef de musique parle si bien qu’il obtient. On rit beaucoup.
Vers 6h30 nous rentrons à Charmontois-l’Abbé.
Réellement nos cuisiniers nous font honneur. Nous trouvons une table dressée dans la grande salle. Rien n’y manque. Nos poilus ont dévalisé la mère Azéline qui est déjà assise à la place d’honneur.
Nous nous mettons à table au milieu d’une rigolade générale. À présent il n’y a plus qu’une chose à obtenir, c’est d’allumer du feu dans la pièce que nous occupons. Cela aux dires de la maman est impossible car la cheminée est bouchée.
On se quitte à 8h30 après avoir fêté notre propriétaire tout heureuse qui dort sur la table.
Dans la pièce il y a un lit immense. Lannoy et moi en héritons. Jamesse nous a quittés à 8 heures pour se rendre chez le maire assez aimable pour lui faire profiter de la chambre laissée vacante par sa mère. Le veinard, il est choyé.
Quant aux autres, un vaste grenier rempli de bonne paille leur sert de refuge.
Nous sommes obligés de coucher la mère Azéline qui n’est pas habituée à nos libations. Quel fou rire !
Nous quittons la maison Azéline par un beau clair de lune et filons à travers champs vers la maison Adam. Lannoy et Culine me disent, chose que j’ignorais, que les demoiselles nous ont gardé nos lits. Nous passerons donc nos nuits là-bas.
Nous arrivons et trouvons des sous-officiers du génie occupés à faire popote. On cause avec eux et nous disons bonjour à nos amis Adam. Ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas de chambre, nous disent-ils, une demi-heure après, quand nos camarades du génie sont partis se coucher. Ils ont dû accepter quand même la popote des sous-officiers et le bureau de la compagnie qui s’est installée dans la maison d’habitation.
Nous nous couchons, mais nous décidons que ce sera la dernière fois. Nous ennuyons plutôt de braves gens, nous sommes éloignés de notre cantonnement, nous en sommes en dehors et n’avons pas le droit de loger ici. De plus si nos amis du génie ont vent de l’affaire, des ennuis pourraient nous être causés.
[1] catachrèse : Il s’agit sans doute ici d’une erreur de vocabulaire. Catachrèse n’a évidemment aucun sens ici (fig. de style !). Le mot qui conviendrait le mieux est cacochyme !
[2] écot : Quote-part incombant à chacun, dans une dépense commune : Payer son écot.
[3] Couvet : pot plein de feu et de cendres
[4] dithyrambe : Louange enthousiaste et, le plus souvent, démesurée, exagérée ; panégyrique.