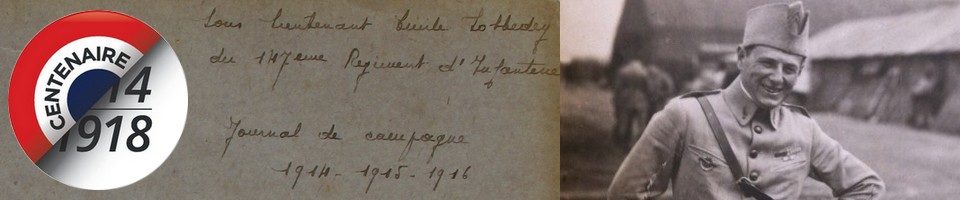C’est aujourd’hui le jour des Morts. C’était hier la Toussaint. Il n’y paraît pas beaucoup par ici.
Les voitures de ravitaillement sont stationnées dans la rue. On attend le régiment.
Il peut être 2 heures du matin quand il s’amène, notre beau bataillon, désemparé, vanné et démoli.
Je vois le sous-lieutenant Vals qui stationne avec sa troupe. Peu après, c’est le capitaine à cheval.
On place la compagnie dans les granges et différentes maisons abandonnées, tant bien que mal. J’avertis le capitaine que des coins sont occupés par des fractions isolées qui n’ont aucune discipline, aucune politesse, aucun droit et opposent la force d’inertie.
Ce n’est pas long. Une descente de cheval rapide, une entrée qui ressemble à un cyclone ; en 10 secondes, la place est déblayée. Les dormeurs se trouvent dehors, ayant chacun reçu coups de pied et coups de poing en guise de réveil, face à un homme hors de lui qui leur demande s’ils en ont assez. C’est ma revanche et je suis pris d’un fou rire.
J’ai trouvé pour mes officiers un coin de maison dont une partie est habitée par un homme hirsute et sa femme d’une amabilité d’orang-outan. Encore ce coin m’est-il disputé par mon ami Carpentier qui n’a rien trouvé et déclare que c’est mitoyen. Enfin, ces messieurs s’installent dans une pièce aux carreaux cassés, dont les trous sont bouchés par du carton. Une table, un fauteuil, trois chaises. Cela suffit. Un malheureux lit se trouve au fond de la pièce sans draps ni couvertures ; sommier et matelas font pitié. Le cuisinier Chochois et son auxiliaire Chopin sont dans une pièce à côté qu’ils ont dénommée du nom pompeux de cuisine, mais qui a tout d’une écurie.
Je rejoins les cuisiniers qui s’ingénient à faire du feu avec du bois mouillé et soufflent sur les cendres à pleins poumons.
Je m’installe près du feu, grelottant, afin de me sécher et d’attendre le petit jour. Il faut absolument que je trouve autre chose. Pour cela, il faut attendre que les habitants soient levés.
Je somnole, fatigué, pendant qu’à côté j’entends les éclats de voix des officiers de 5e et 8e ; ces derniers n’ont rien comme logis.
Au petit jour, je continue ma randonnée. Je trouve une arrière-cuisine abandonnée avec un lit au fond. Il faudrait néanmoins un bon coup de balai et un nettoyage en règle. Je destinais cela au lieutenant Vals. Il n’a pas vu cela, il se dit malade et indigné que j’aie pu songer à lui procurer cela.
Je cherche ailleurs et rencontre un homme aimable qui fait fonction de maire et me donne une maison abandonnée, de deux pièces assez potables. Heureux suis-je quand j’apprends que ce coin appartient au 1er bataillon.
Je tourne alors mes vues vers le pâté de maisons qui se trouve en dehors du village, sur la route de Florent. Je suis désespéré.
Enfin, je tombe dans une maison proprette, habitée par un ouvrier et sa fille. Aimables, ces gens qui n’ont pas ouvert la nuit, acceptent de donner une chambre à deux lits. Je suis sauvé.
Je file alors rejoindre la liaison et trouve mes amis dans la rue, occupés à visiter, revisiter et contre visiter des demeures déjà vues cent fois. Il n’y a rien, rien de potable.
Je visite notre hôtel. Dans la première pièce, ignoble, Gauthier met un peu d’ordre et allume du feu. Dans la seconde, à l’arrière, je retrouve mon sac qui gît au milieu du désordre répugnant de la salle. Je monte au premier et rencontre deux chambres où le désordre le plus complet règne également.
Une idée me prend. J’appelle les fourriers*. Nous nous mettons à l’œuvre. On mettra de l’ordre et fera un nettoyage complet des deux pièces. Dans l’une, nous placerons les lieutenants Péquin et Monchy, dans l’autre, nous nous installerons, ce sera notre chambre à coucher.
Il est plus de midi quand le résultat est obtenu. Le lieutenant Péquin amène le lieutenant Régnier. Monchy fut invité par Vals, le capitaine Aubrun désirant rester seul et garder la pièce de la veille au soir. Le confort de la chambre est mesquin : une chaise, deux lits n’ayant que le sommier, une glace, un point c’est tout. Ces messieurs sont heureux quand même car ils n’avaient rien.
Pour nous, la seconde pièce possède un lit et une table. Le plancher nous suffit pour reposer ; il vaut bien le fond d’une tranchée. Nous nous installons et malgré tout, nous sommes heureux.
L’après-midi se passe à se nettoyer. Au moins cette fois, je ne suis pas ennuyé au point de vue du linge : la voiture de compagnie est là, je vais la voir et trouve mon ballot.
Vers le soir, enfin, l’installation est terminée. Chacun y a mis du sien, le bas, comme le haut, sans être propre, n’est plus dans l’état répugnant où nous l’avons trouvé. Nous mangeons de bon appétit et nous couchons, du moins c’est une façon de parler, nous étendons de bonne heure.