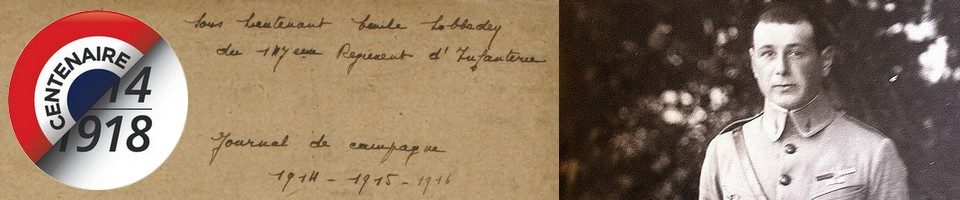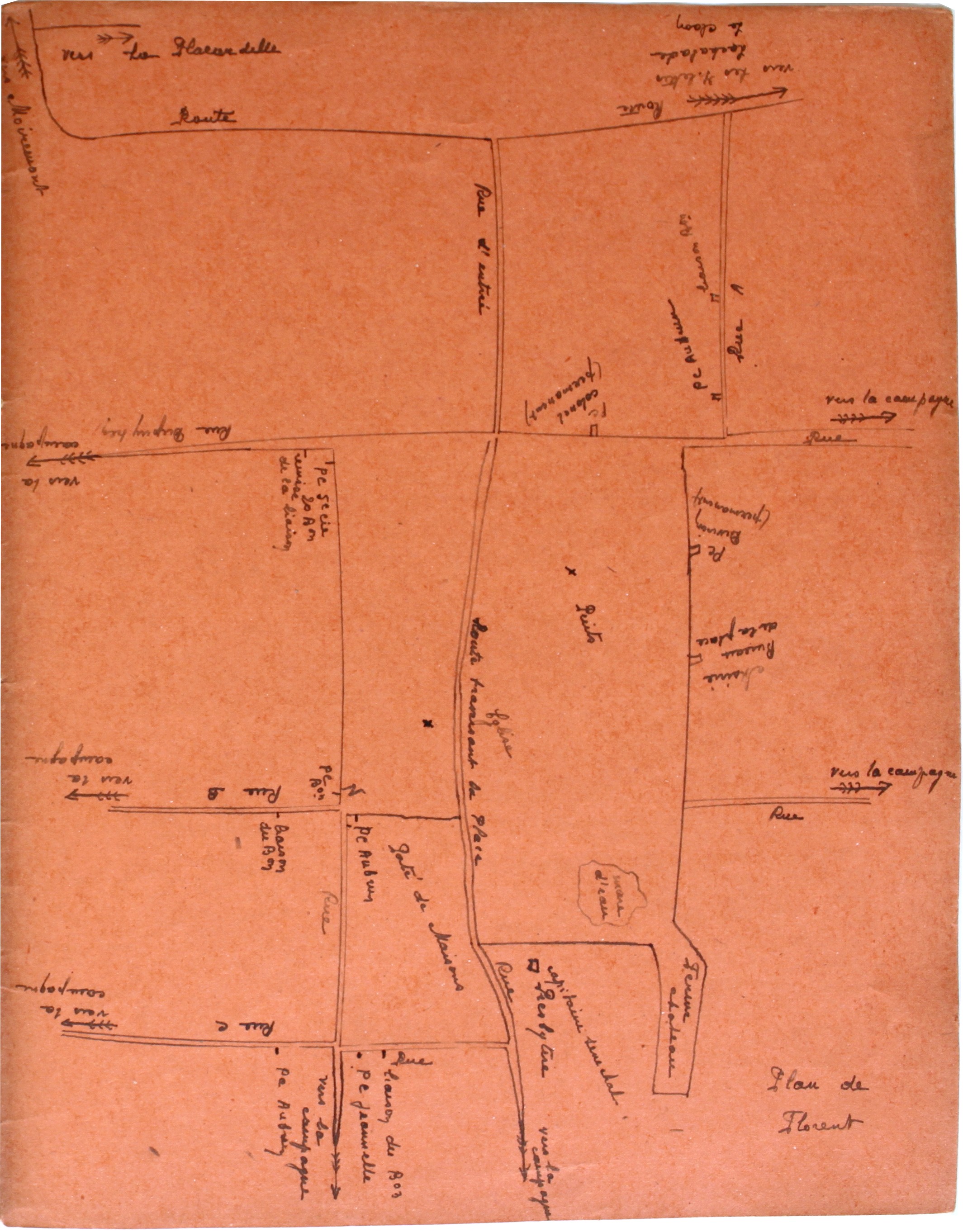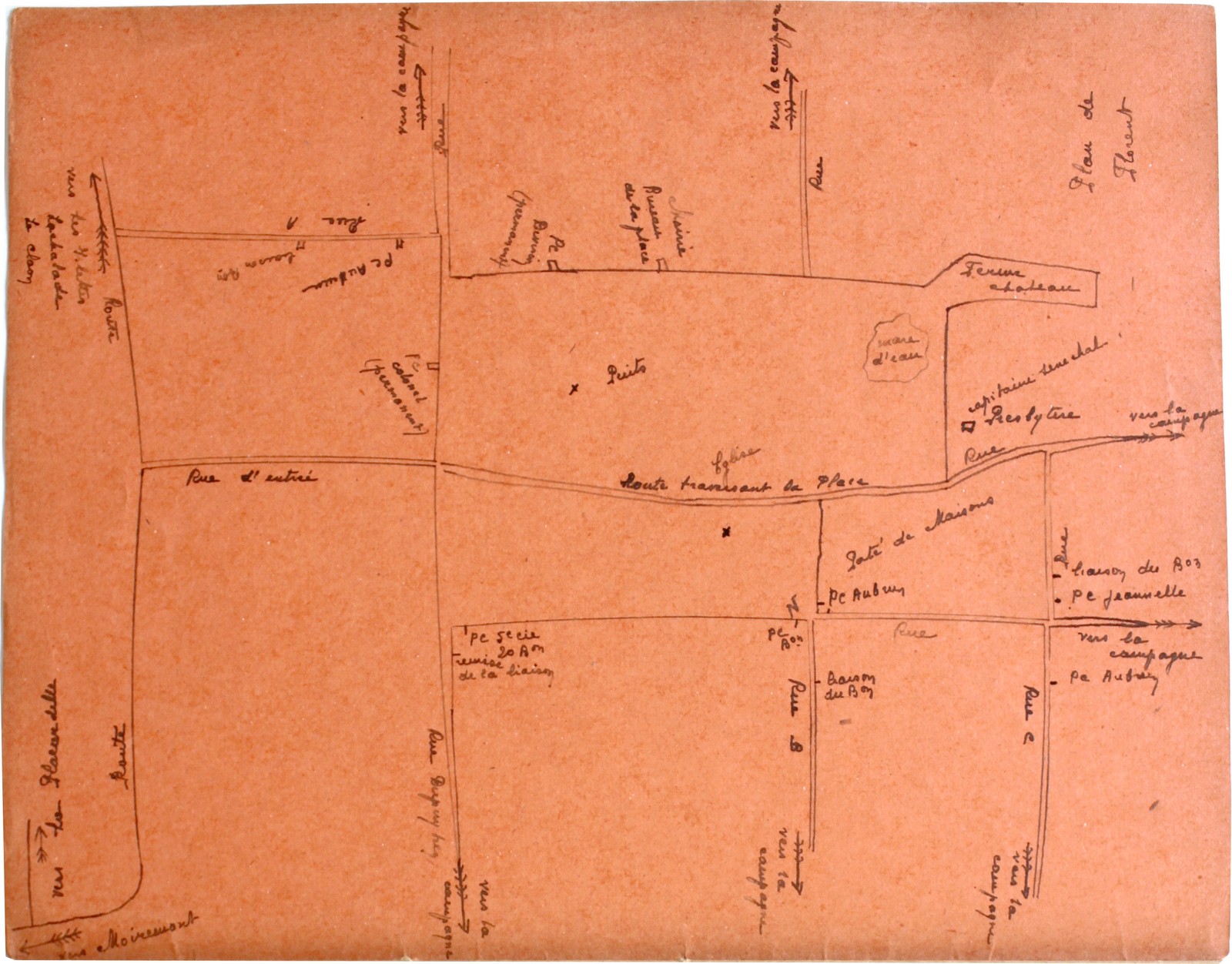Au jour je suis debout. Lannoy et les amis s’amènent. On prend le chocolat traditionnel. À l’ouvrage, le bureau, tandis que la compagnie part à 7 heures à l’exercice.
Licour va chercher chez le tailleur du régiment, un de mes amis du pays, nos tuniques à Lannoy et à moi. Il nous les apporte brillamment galonnées. Nous les endossons aussitôt.
Réellement, maintenant, je suis nippé. Où est le temps où je n’avais plus de sac, plus rien, sinon cette malheureuse chemise sur le dos ?
À la rentrée de l’exercice, le capitaine s’amène et dicte le travail de l’après-midi. Exercice de 1 heure à 2 heures 30 sous la conduite du sergent Gibert. Nettoyage des armes à la rentrée. Revue d’armes à 4 heures par les chefs de section. Notre commandant de compagnie nous félicite sur notre tenue et se déclare satisfait d’avoir un bureau à [la] hauteur.
Après son départ, nous nous mettons à table. Culine arrive, relevé de son poste de garde. Il mange de bon appétit en tonnant contre toutes les chinoiseries du colonel Desplats. Lui aussi a eu la menace d’être cassé. Ce n’est certes pas une sinécure d’être chef de poste. Il nous fait bien rire en nous racontant une nouvelle aventure arrivée à Bibi, le sergent de la 8e, notre glorieux catéchumène que Culine a relevé.
Bibi étant chef de poste avec la section, reçoit la visite du chef de corps. Il fait sortir les hommes et leur fait présenter les armes. Le colonel l’eng… comme un pompier au sujet de la tenue des hommes qui n’est ni propre ni uniforme et lui dit en matière de conclusion « Vous serait cassé ! Vous êtes cassé ! Considérez-vous comme cassé ! ». Bibi ne bronche pas. Mais tandis que le colonel passe dans la grange qui sert de poste de police et continue son inspection, notre sergent tire posément son canif et en un tour de main enlève les deux morceaux de galons réglementaires qu’il a sur les manches.
Le colonel sort et au moment où il va filer, Bibi s’approche simplement de lui, « Tenez, mon colonel ! » lui dit-il en lui tendant les deux galons.
Celui-ci, fou furieux, les yeux lançant des éclairs, tonne, fulmine et lui crie « Vous aurez un mois de prison ! – Vous aurez deux mois ! – Vous serez dégradé ! – Vous passerez en conseil de guerre ! – ». Bibi, présentant les armes, ne bronche pas, mais il regarde lui aussi le colonel avec de grands yeux comme seul peut en avoir un vieux colonial. D’ailleurs, lui-même comme le colonel ont connu Madagascar et la Cochinchine. Bibi n’a-t-il pas la médaille de Chine, celle du Tonkin et celle du Maroc !
Et soudain, le colonel se reprend et se met à rire, puis de nouveau féroce « Vous resterez sergent, entendez-vous ; et je vous donne l’ordre de recoudre vos galons. Ce soir, vous viendrez me saluer chez moi et vous présenter ».
Le plus tranquillement du monde, Bibi fit rentrer le poste de police et le soir il allait voir le colonel. Il en revint enchanté et disait du coup « Mon ami le père Desplats ». Le colonel lui avait fait avaler plusieurs verres de vin, un dessert, le café et le pousse-café, l’avait fait asseoir à sa table, lui avait serré la main et déclaré qu’il était le meilleur sous-officier du régiment. Quel fou rire nous prend en entendant tout cela.
Enfin nous sortons de table. Au-dehors, il fait un soleil magnifique. Le temps est toujours beau. Nous n’avons pas encore eu une goutte de pluie depuis notre arrivée ici.
À 2 heures, nous sommes dans l’église. Celle-ci est remplie. Les officiers sont en tête, ayant derrière eux les sous-officiers. Tout le monde est assis. Le colonel s’amène vêtu de son énorme peau d’ours. On se lève. Notre chef de corps monte jusqu’au banc de communion et dignement se retourne en nous faisant signe de nous asseoir.
Durant une heure, il nous fera théorie comme à de vulgaires 2e classe ; il nous émettra ses idées qui pour le moins paraissent baroques. Il fait des phrases en se promenant dans l’allée centrale, tire sa peau d’ours, la remet, fait des gestes, des grimaces. Malgré tout le respect dû à l’autorité, nous ne pouvons nous empêcher de rire.
Il s’écrie soudain : « Quand je sors, qu’est-ce que je vois ? – Rien. »
En effet, il suffit qu’officiers ou soldats voient sa silhouette pour filer à l’anglaise d’un autre côté. « Quand je sors, qu’est-ce que j’entends ? – Rien ». Je vois le capitaine Sénéchal qui se tient les côtes.
À côté de moi, j’ai le capitaine Guepin qui dit « Ballot ! Ballot ! Ballot ! » et ressasse sans cesse la ritournelle.
« Le soldat français est toujours de service, 24 heures de service, toujours des service. »
« Le soldat ne doit causer que service, les sous-officiers que service, les officiers que service. »
« Le soldat ne doit penser qu’à la guerre, les sous-officiers qu’à la guerre, etc… »
Et sous la forme de commandements, il nous expose ses théories.
Durant une autre heure, il se met à interroger Pierre, Paul et Jacques ; mais à sa façon. Il prend Maxime Moreau et lui demande « Combien de temps par jour, un soldat est-il de service ? » – Maxime sans broncher répond « 24 heures ! »
À un autre sergent, il demande « De quoi un sous-officier doit-il parler ? »
Le camarade répond « De la guerre » et notre chef de lui dire « Non, mon ami, du service ! » Et il fait asseoir le sergent ahuri.
Recommandation est faite aux chefs de troupe, que ce soit compagnie ou fraction de compagnie, d’avoir sur eux le contrôle de leur unité. Et nous sommes libres !
Que d’impressions à se communiquer ! On peut en juger par les nombreux groupes qui se forment et les rires qui fusent.
Les officiers des 1er et 3e bataillons ne tardent pas cependant à reprendre la route de Sénard et Belval.
Nous rentrons au bureau où nos amis, Culine et autres nous suivent. Ils vont faire un tour pour leur revue d’armes, il est 4 heures, et nous donnent rendez-vous chez La Plotte.
Au bureau, Licour me remet une lettre de ma chère mère et un colis annoncé qui vient d’arriver. Je suis tout heureux d’y découvrir quelques friandises et en particulier un portefeuille très beau en remplacement du mien tout usagé. Ma mère me parle qu’elle possède chez elle un charmant monsieur, lieutenant Davion, chef de convois automobiles, avec qui elle converse longuement le soir et qui lui fait oublier un peu les tristesses de l’heure présente. Cette lettre me fait grand bien.
Gaiement, je pars donc avec Lannoy à Charmontois-le-Roi après avoir recommandé aux cuisiniers de faire un repas digne d’eux. En route, nous disons qu’il faudra songer à saluer un de ces temps la famille Adam qui peut croire que nous l’oublions. Chez La Plotte, la cuisine est remplie. Marie est à la place d’honneur et boit sec. Il est des plus intéressants ce vieux brave. À peine rentrés, le fou rire nous prend, il ne nous quittera plus jusqu’au coucher.
Nous passons 2 heures des plus agréables. Sur les instances de mes camarades et des gendarmes, j’attaque une chansonnette. C’est la première fois que je chante depuis la mort de Carpentier. Enfin, gaiement toujours, nous rentrons chez nous.
En route, Culine rencontre un de ses amis, sergent du génie. Pris d’une affection sans bornes, Culine l’embrasse et veut à tout prix qu’il l’accompagne à table. Nous avons donc de ce fait deux invités et Culine déclare noblement que « Plus on est de… fous plus on… on rigole » et en effet, on rit de bon cœur.
Nous nous mettons donc à table. Cette séance est indescriptible. Ce qu’il y a de vrai, c’est que nous sommes en gaieté et qu’à 11 heures Culine et Marie étaient reconduits par Cattelot et moi car on craignait un peu pour la faiblesse de leur vue. Quant à Maxime, il rentre gaillard en se moquant des deux malheureux : il oublie qu’ il y a deux jours il me demandait l’hospitalité. Lannoy est rouge comme un coq et nous avons toutes les peines du monde à le décider à aller se coucher. Quant à Jamesse, je le trouve dans mon lit à mon retour : ce soir il a oublié son gîte à Charmontois-le-Roi.
Je me couche, il est minuit. La table est un vrai champ de bataille. Nous avons vécu une séance mémorable et notre bourse s’est allégée de quelques sous.