Note
À partir du 13 mars, il n’existe qu’une sorte de « plan » écrit par Émile Lobbedey qui indique en quelques mots ce qui devait sans doute être l’objet de son développement.
Voici ces notes.
Jamesse – Gourbi, etc… Richer Caillou
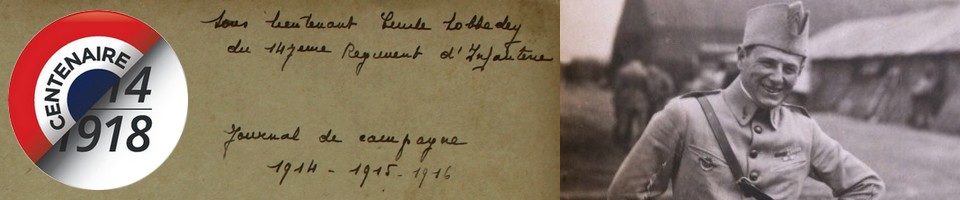
Note
À partir du 13 mars, il n’existe qu’une sorte de « plan » écrit par Émile Lobbedey qui indique en quelques mots ce qui devait sans doute être l’objet de son développement.
Voici ces notes.
Jamesse – Gourbi, etc… Richer Caillou
Au réveil, je cause longtemps avec Jamesse de la compagnie. Nous faisons les pièces ensemble. La compagnie comprend 110 hommes. Le commandant de compagnie : le lieutenant Richer, que j’ai connu à Sedan, officier d’administration. Il a demandé à la mobilisation d’être incorporé dans le service armé. Il a gagné son deuxième galon. Blessé dans l’Argonne dans le 147e, il vient de rentrer. Chef de la 1ère section : sous-lieutenant Caillou, de réserve, instituteur, déjà blessé au 147e en Argonne, venant d’arriver avec le renfort. Je prends le commandement de la 3e section et du 2e peloton. Les deux autres sections sont commandées par un sergent : le sergent Radelet, la 4e, le sergent Taveaux, la 2e.
Dans la matinée, je vais voir la 3e section. J’ai un sergent récemment nommé, Pignol, mon ancien agent de liaison, qui se trouve dans un gourbi avec Lasire, un de nos caporaux, ex–ordonnance du sous-lieutenant d’Ornant, nouveau promu. Je passe le commandement de la 2e demi-section au caporal Dédisse arrivé en renfort.
Je parle aux hommes et les émoustille un peu. J’examine notre situation. Nous sommes au haut d’une crête, à 1200 m à droite du village de Mesnil. À 600 m devant nous se trouvent les premières lignes, dans une vaste plaine couverte de cadavres et de tranchées boyaux. À 1000 m se dresse une crête comme la nôtre, appelée cote 174 et occupée par l’ennemi. Nous sommes en réserve du 174e d’infanterie.
Quand j’ai vu tout cela, je vais me présenter au lieutenant Richer dont le gourbi est à 15 m du mien. Il me reçoit très bien. Je suis à 50 m de ma section.
Voici d’ailleurs le topo succinct de la position de la compagnie.
Note
À partir du 13 mars, il n’existe qu’une sorte de « plan » écrit par Émile Lobbedey qui indique en quelques mots ce qui devait sans doute être l’objet de son développement.
Je fais une excellente nuit. Le coin est calme et je me réveille sans le secours d’aucune marmite, ce qui est souvent l’habitude. Il fait jour et un rayon de soleil filtre à travers la toile de tente. Il est 8 heures. J’ai dormi douze heures sans interruption. Du moins, je me sens retapé.
Mes provisions s’épuisent. Je me rends donc près de la liaison du bataillon et vois Erhvein avec qui je cause service. Il a du travail avec les notes, états, etc… J’attends Gauthier qui arrive vers 10 heures et me remets ma part de boisson et de nourriture.
Je rentre alors à mon poste. Dans le boyau que je suis, un obus est tombé après mon passage, causant une large brèche. Il faut se baisser pour passer. Je tombe dans la 7e, puis dans la 8e compagnie, puis voici mon abri.
Je mange puis me rends faire acte de présence près du PC du colonel. C’est bizarre, je ne joue aucun rôle. Décidément, qu’est-ce que je fais ici ? Après une heure en plein air, tandis que quelques obus s’égarent de ce côté, je juge prudent de me mettre à l’abri et rentre chez moi où j’ai tout loisir de songer sérieusement à ma situation.
Voici : je fus nommé adjudant à la 5e compagnie. C’est l’affectation officielle. Oralement, par une combinaison vaille que vaille, et au fait sans valeur, je fus attaché à la liaison du bataillon. Me voici maintenant, par un imbroglio, attaché au colonel, sans rôle sérieux, rabaissé au niveau d’agent de liaison dont on ne se sert pas, puisque personne ne s’occupait de moi. Je ne joue ici aucun rôle, je n’en joue pas non plus à la liaison du bataillon. Par contre, je suis toujours nommé à la 5e compagnie, je n’ai pas été remplacé. Là-bas, les chefs de section manquent. Ici, j’ai l’air de m’imposer, jusqu’au jour où on pourra s’étonner que je n’aie pas rejoint mon poste. Au fond, ma place est à la compagnie. J’y vais.
Et c’est ainsi que vers 4 heures, j’arrivais près de Jamesse qui, installé dans un gourbi, faisait le sergent major. Je m’installe près de lui, nous causons, je lui explique ma situation, il est entièrement de mon avis. Nous mangeons. Je décide d’attendre jusqu’à demain. Si on ne m’a pas réclamé, je prends possession de mes fonctions d’adjudant de compagnie.
Nous nous étendons côte à côte, contents mutuellement d’être l’un près de l’autre. Une forte amitié s’établit entre nous ; nous sommes veufs de nos camarades, héritiers d’un passé d’amitié et des souvenirs de ceux qui ne sont plus, seuls survivants de notre chère bande de Charmontois.
Vers une heure du matin je suis réveillé par Mascart qui m’apporte toutes les nominations. Il m’annonce que je suis adjudant à la 5e et non au bataillon. Un renfort est arrivé hier à 9 heures. Les nominations ont été rectifiées. Un adjudant du renfort Erhvein est nommé à ma place et je passe à la 5e compagnie.
À la lueur d’une bougie nous nous levons et nous mettons à copier l’état des nominations et des mutations. Je ne puis en croire mes yeux. Des surprises me sont encore réservées : Jamesse est nommé sergent fourrier et non sergent major ; Jacquinot caporal fourrier à la 5e ; Delbarre caporal fourrier à la 10e.
D’autres notes disent que le lieutenant Richer commande la 5e compagnie le sous-lieutenant Caillou passe également à la compagnie.
Aussitôt sur la copier les fourriers partent porter toutes ses copies à leur compagnie tandis que je réveille le commandant Triol à qui je rends compte. Je suis furieux, car je trouve la chose injuste. Le commandant me dit qu’il me garde jusqu’à nouvel ordre et en causera au capitaine adjoint, Claire.
Je me rendors affreusement triste.
Vers 4 heures j’étais en plein sommeil de nouveau je suis de nouveau réveillé par une nouvelle note. Cela me rend furieux tout à fait puis presqu’atterré. Je lis :
Rassemblement du régiment aujourd’hui à 8h30. Départ pour la première ligne à 9 heures.
Cela est plus qu’une douche glacée. Je vais trouver le commandant qui dicte ses ordres. Rassemblement du bataillon à 8h15 les compagnies devant leur cantonnement. Formation en colonne double à 8h30 devant et à 100 m du cantonnement du bataillon.
Nous copions de nouveau afin de communiquer les ordres. Décidément ce n’est pas du repos.
Je me recouche quand même une heure.
Mais à 6 heures il faudra être debout, car il y a encore la répartition du renfort à faire. Quel métier !
À 6 heures je suis debout, boucle mon fourniment et me mets en tenue de départ après avoir enlevé mes galons de fourrier. Je sors ; le commandant et dehors. Je bois le café de Gauthier.
Le capitaine Claire ne tarde pas à se montrer. Devant le cantonnement une masse de 250 hommes attend d’être répartie. Le capitaine vient à nous ; le commandant lui dit son étonnement de mon affectation. Claire déclare qu’Erhvein [ Ervein ?] est rhumatisant, malade et ne pourrait remplir les fonctions d’adjudant de compagnie. Par contre je n’ai moi qu’à rester à la disposition du commandant Triol.
Claire fait appel de la camaraderie au sujet d’Erhvein. Enfin il bredouille assez ennuyé. Le commandant me dit donc de rester avec lui. Je vois pourtant que bientôt je serais un intrus ou du moins que je ferai le travail de l’adjudant de bataillon sans en avoir le nom. De toute façon je suis très peu satisfait malgré mon nouveau galon. Il y a eu un passe-droit ni plus ni moins.
Delbarre arrive peu après vers moi en larmoyant parce qu’il doit quitter la 5e. Je l’envoi promener, j’ai autre chose à faire et moi-même je suis furieux.
Puis le lieutenant Collandre vient me serrer la main. Il est en furie et me déclare qu’il va à l’instant se faire évacuer pour rhumatisme. Il n’accepte pas qu’on lui enlève le commandement de la 5e et qu’on le mette sous les ordres d’un plus jeune.
Enfin le temps passe ; vers 8 heures au milieu d’une forte pagaille présidée par le capitaine Claire la répartition du renfort se fait. Je vois l’ex sergent major du trésorier, Levêque aujourd’hui adjudant, qui malgré tous ses efforts n’a pu rester à Saint-Nazaire et vient pour la première fois au feu. Je vois également l’adjudant Faure qui se trouve dans le même cas.
Je fais connaissance avec l’adjudant Erhvein qui arrive. C’est un Sedanais, ex sergent de réserve à la 6e compagnie, celle du capitaine Claire, nommé adjudant par lui et évacué pour rhumatismes en novembre.
Ce n’est pas étonnant ce n’est pas étonnant qu’il me soit passé sur le dos. Enfin on fera bon ménage quand même.
À 9 heures nous partons liaison en tête avec le commandant Triol. Nous traversons la voie ferrée au passage à niveau et arrivons sur la route Somme-Tourbe Somme-Suippes. Nous la traversons également et filons à travers champs, les trois bataillons en colonne.
Sur la route le lieutenant Collandre m’a dit au revoir. Il est évacué.
Nous faisons une pause non loin de batteries d’artillerie lourde dissimulées dans un bois de sapin. Il y a réunion d’officiers. Je vois un nouveau lieutenant-colonel arrivé ce matin, me dit Erhvein, le lieutenant-colonel Pichat qui rentre de blessure prise à la Marne, officier de la Légion d’honneur.
Nous filons par monts et par vaux par petits paquets dans la direction des abris Guérin. Nous passons rapidement des crêtes, allant de bois de sapin en bois de sapin sont nombreux par ici. Les compagnies marchent par section à 250 m.
Il peut être 2 heures quand nous sommes en vue des abris Guérin que nous gagnions au pas de course à la sortie d’un bois. C’est ensuite un grand ravin. Nous sommes à l’abri des vues de l’ennemi désormais. Nous ne recevons pas d’obus sinon deux ou trois shrapnels qui arrivent là par hasard.
Le régiment arrive par petits paquets et s’installent dans les abris Guérin. Il est 2 heures de l’après-midi. Le commandant Triol m’envoie me mettre à la disposition du lieutenant-colonel Pichat.
J’arrive à son abri et me présente. Je suis bientôt chargé d’une mission. Je dois me rendre par les boyaux à Mesnil-les-Hurlus. De là prendre tel boyau, me faire indiquer telle tranchée et demander le général qui commande le secteur. Je dois lui annoncer que le 147e est arrivé aux abris Guérin à sa disposition et me mettre moi-même à la disposition du chef de secteur.
Je pars donc. Ma mission est difficile mais je veux m’en bien n’acquitter. J’arrive sans encombre à Mesnil-les-Hurlus que pour la première fois je vois en plein jour.
Je vois un capitaine à qui je demande des renseignements qu’il me donne très aimablement. J’arrive ainsi à peu près à mon endroit m’informant à chaque carrefour aux cuisiniers qui descendent. Heureusement que le boyau n’est pas marmité.
Un contretemps fâcheux se produit. Le sous-lieutenant de passage me dit de reprendre le boyau vers Mesnil et de filer vite car le général vient de partir par là il y a à peine 5 minutes.
Je file comme un zèbre est non loin de Mesnil, rencontre le capitaine qui m’a renseigné tout à l’heure et me dit que c’est le général commandant le 16e corps qui vient de passer, de retour d’une visite qu’il vient de faire au secteur.
Force m’est donc tout en pestant de reprendre ma route. Enfin suant et soufflant j’arrive à mon but. Je vois le général lui-même des plus bienveillants. C’est un ancien colonel du 8e d’infanterie que je connais. Je lui donne mon nom et nous parlons de l’évêque d’Arras, mon oncle que le général qualifie de « grand patriote ». Je puis rentrer au 147, car le poste est relié téléphoniquement à un poste non loin des abris Guérin.
Je rentre donc un peu doucement, car je sue sang et eau. Trois heures après, vers 5 heures, je rends compte de ma mission au colonel. Ce n’est pas sans mal que je ne me suis pas égaré. Je suis sain et sauf et les marmites se sont faites rares.
Je m’installe près du poste du chef du régiment avec quelques sapeurs dans un petit abri et me repose de ma randonnée. Je n’ai plus de havresac et j’en suis heureux ; j’ai lâché aussi le fusil pour le revolver de Gallois et ses jumelles que j’ai héritées. J’ai mes couvertures et ma toile de tente roulées en bandoulière.
Vers 7 heures nous quittons les abris Guérin. Les bataillons partent individuellement à leur poste assigné. Je fais partie de la liaison du colonel que je suis avec le capitaine Claire. Nous nous arrêtons à 800 m de là dans un grand boqueteau où se trouvent à quelques abris. Un poste téléphonique est installé. Le colonel rentre et je vois les capitaines d’état-major de notre brigade, Brunet et Garde. Après un quart d’heure de conversation, le colonel sort et nous filons rapidement par un petit clair de lune en longeant le boyau vers Mesnil-les-Hurlus. Les boches n’envoient aucunes marmites. Non loin devant nous le feu d’artifice des fusées marche bon train.
Dans le village, je suis laissé par le capitaine Claire pour attendre le 2e bataillon qui va arriver afin de l’amener à son emplacement qui n’est autre que le poste du général de brigade reconnue par moi cet après-midi, où le commandant Triol recevra ses instructions.
Heureusement pour moi d’agents de liaison ne tarde pas à arriver dans Mesnil-les-Hurlus. J’en prends aussitôt la main.
Survient le 3e bataillon en tête. Le commandant Vasson me voit. Je lui donne un agent de liaison. Il me charge de vouloir bien faire la police afin que les hommes suivent en file rapprochées et ne prennent pas une fausse direction. Je passe donc une demi-heure à cela. Le bataillon est enfin passé. Il peut être 9 heures. Quelques marmites éclatent assez près. Je suis trop préoccupé pour m’en occuper.
Voici le commandant Triol. Je vais au-devant de lui, prends avec moi un agent de liaison disant aux autres de prendre le premier bataillon après le passage du 2e. Nous marchons en tête du bataillon et nous engageons dans le boyau à 100 m de l’église.
Après bien des stationnements dus au 3e bataillon qui n’avance pas, un empêtrement inouï dans les boyaux, ce qui nous demande bien 2 heures de marche et nous procure quelques bons bains de boue, on arrive enfin. Le commandant Triol va prendre ses instructions tandis que je m’éclipse avec deux hommes de la 5e que je prends comme agents de liaison du colonel au commandant.
Mon rôle est terminé ; je dois rejoindre le poste du colonel. Où est-il ? Grave question que je ne résous qu’à 3 heures du matin.
Je n’insiste pas sur mes marches et contremarches. J’assiste au défilé des troupes relevées durant près d’une heure avec l’espoir que l’homme qui passe est toujours le dernier.
Enfin je tombe presque au petit jour dans la 7e compagnie. C’est là qu’on m’apprend que le colonel est installé non loin dans un petit bois, toujours du genre des manches à balais du Trapèze. Je rencontre également la 8e compagnie et vois l’adjudant Vannier me renseigne sur un gourbi vide non loin.
Je m’installe là avec mes agents de liaison qui bouchent l’entrée d’une toile de tente. Je ne m’occupe plus de rien, incapable et ne songeant qu’à dormir.
Quelle chance que l’artillerie ennemie ait été calme. Sinon je n’aurais pas répondu de la casse.
Roulé dans mes couvertures, la tête sur mon sac, je dors comme une marmotte quand vers 4 heures je suis réveillé par Mascart qui est toujours à la liaison du colonel. À la lueur d’une bougie je lis la note qu’on m’apporte :
« Départ du régiment à 9 heures. Le régiment se rassemblera, les bataillons devant leur cantonnement à 8h45. Il change de cantonnement pour se placer au-delà de la voie ferrée. Le capitaine Delahaye et le campement des trois bataillons partira à 7 heures. »
Je file chez le capitaine Triol que je réveille. Tout est à communiquer. Ordres de compagnies 5, 6, 7, 8. Campement avec le sergent fourrier Jombart rassemblé à la sortie du cantonnement à 6h45.
Je reste avec le capitaine et la liaison. Celle-ci copie la note et se rend près de chacun de ses commandants de compagnie.
Moi je repique un somme interrompu.
À 6h30 nous buvons le café tandis que Jombart, Verleene et Sauvage s’équipent. Jamesse me remplacera pour le cantonnement de la compagnie. Ils s’en vont suivis de Gauthier.
Je trouve pourtant tout ceci exagéré. Nous n’avons décidément pas le temps de nous nettoyer.
À 8h45 je vais trouver notre commandant du bataillon tandis que le bataillon se rassemble. À 9 heures nous partons suivant le 1e bataillon. Nous sommes bientôt sur la route. Il fait beau soleil. Nous ne tardons pas à atteindre Somme-Tourbe que nous traversons et dont on peut admirer les ruines.
Nous tournons à droite. Je vois le sous-lieutenant trésorier Simon à qui je dis bonjour. Nous prenons la route de Suippes. Le passage y est tellement fréquenté que nous longeons la route à travers champs. Enfin arrivés non loin d’un parc d’aviation, nous traversons la route puis la voie ferrée et nous arrêtons en tournant à droite dans un vaste terrain inculte. On fait la pause en attendant de se loger dans les abris que nous apercevons à 600 m.
Bientôt arrive Jombart suivi des fourriers. Il vient rendre compte au capitaine Triol. Ce ne sont pas des baraquements. Ce sont des abris, assez confortables. Le cantonnement par contre et d’une malpropreté repoussante.
Les compagnies partent tandis que je suis mon chef avec la liaison. On s’installe. Aussitôt je fais communiquer une note disant qu’il faut procéder d’urgence aux travaux de propreté du cantonnement et des hommes, porter tous les détritus à un endroit fixé, y mettre le feu et creuser des feuillées à 200 m des abris, les cuisines à 100 m, en arrière. Pour l’eau, il faut en chercher au passage à niveau où il y a un puits.
Le capitaine Triol prend un abri. J’en prends un grand à côté pour la liaison. Gauthier a mis la main sur un autre où il pourra faire sa cuisine en toute sécurité.
J’obtiens de lui de l’eau. Je me débarbouille aussitôt pendant que Frappé qui s’occupe un peu de moi va à la voiture de compagnie située devant le cantonnement afin d’y prendre mes affaires dans le coffre. Une heure après je puis me montrer. Je suis propre les souliers même cirés par Frappé qui a du cirage. Je suis transformé complètement et la fatigue a presque disparue.
Notre gourbi est potable. Nous le nettoyons un peu. La liaison se rapproprie comme moi. Nous avons une table, nos sacs nous servent de bancs. Il y a même de la paille quasi fraîche. Nous sommes heureux.
Il peut être midi et demi.
Les voitures de compagnie arrivées en même temps que nous se trouvent devant le cantonnement de chaque compagnie. Je vais voir Jamesse. Il est dans un gourbi avec Delbarre et déjà s’acquitte de sa comptabilité. Je discute avec lui. Il sera sergent major, Delbarre sergent fourrier, Jacquinot caporal fourrier et Lasue caporal d’ordinaire. Je lui conseille de faire cet état de proposition que sûrement le lieutenant Collandre signera. Je lui dis que je suis à sa disposition pour tous renseignements.
Je rentre bataillon ou d’avalanche de notes nous tombent. État des pertes, état de propositions, nettoyage etc… Je fais tout communiqué aux compagnies et communique le tout au capitaine Triol que je félicite et à qui je présente sa nomination de commandes. À son tour il me dit combien il m’apprécie et me propose brillamment pour le grade d’adjudant de bataillon.
Je rentre tout heureux et annonce la nouvelle à la liaison qui me félicite. Je crois que c’est une première vraie joie depuis le début de la campagne.
L’après-midi se passe. On installe le téléphone dans le gourbi du commandant Triol. Je ramasse successivement toutes les pièces et en ai aussi jusqu’au soir.
Je vais saluer le lieutenant Collandre qui est occupé à tripoter dans ses cantines. Il me parle de mon nouveau galon et est tout heureux d’apprendre la bonne nouvelle.
Nous mangeons vers 4 heures. Puis Gauthier part aux distributions à Somme-Tourbe.
Je vais à plusieurs reprises voir le commandant avec les états des compagnies et j’envoie leurs états de propositions avec le mien. J’écris rapidement une carte aux miens pour leur annoncer la bonne nouvelle.
Il peut être 8 heures quand je suis appelé au téléphone. C’est Pêcheur, mon ami, sergent secrétaire qui ne salue d’un retentissant « Bonsoir, mon adjudant ! » Et m’annonce en riant que je suis « juteux de bataillon ». Je me retourne et remercie le commandant qui sourit et se dit aussi heureux que moi.
Et je me couche avec mon entourage qui me félicite. Ah comme je suis heureux et comme je dors de bon cœur.
Capitaine Delahaye commandant du 2e bataillon
Lieutenant Collandre commandant de la 5e compagnie
C’est en somme une nuit blanche. À 4 heures, une fusillade éclate. Nous commencions à nous assoupir. Il faut être debout. Puis c’est le marmitage qui commence, systématique.
Malgré le bombardement, j’ai le loisir de circuler un peu et je puis constater dans quel état sont les secondes lignes. C’est effroyable. Qu’il suffise de dire que les tranchées sont jonchées littéralement de cadavres de blessés morts là en se traînant vers l’arrière. Les parapets* et parados* sont faits de cinq ou six cadavres superposés et recouverts de terre.  Or parfois, un obus est tombé tout à côté défonçant tout, émiettant la terre quand il n’a pas réduit les corps en bouillie ; alors c’est un entonnoir dont les bords découvrent des membres, des troncs, des morceaux de viande humaine. Cette vue n’est pas supportable, malgré tout le caractère et la force d’âme qu’on puisse avoir. Je quitte ce coin peu hospitalier où les marmites* tombent dru et rejoins Pêcheur. Gallois est avec lui ainsi que l’adjudant de bataillon du 33e.
Or parfois, un obus est tombé tout à côté défonçant tout, émiettant la terre quand il n’a pas réduit les corps en bouillie ; alors c’est un entonnoir dont les bords découvrent des membres, des troncs, des morceaux de viande humaine. Cette vue n’est pas supportable, malgré tout le caractère et la force d’âme qu’on puisse avoir. Je quitte ce coin peu hospitalier où les marmites* tombent dru et rejoins Pêcheur. Gallois est avec lui ainsi que l’adjudant de bataillon du 33e.
Vers 9 heures, je suis appelé : on me dit que c’est un lieutenant désigné pour commander la 5e compagnie qui me demande. Je file et vois un officier, la tête bandée. Celui-ci dit s’appeler « lieutenant Collandre », me serre la main et demande de me conduire à la compagnie. Nous filons donc au boyau* Mesnil-les-Hurlus. Après 100 m de parcours, nous trouvons un grand emplacement creusé dans la paroi du boyau, servant de dépôt de matériaux. On s’y installe. J’explique à mon nouveau chef l’odyssée de la compagnie et lui rend compte de mes ordres donnés la veille.
Charmant, le lieutenant me félicite, me dit qu’il me fera nommer adjudant, qu’il me prend à sa table. Nous fumons en attendant le sergent Radelet qui doit amener tout le contingent. Il peut être 11 heures quand Chopin apparaît avec ses marmites. La compagnie suit et Radelet arrive. Il amène tout le monde au complet. Il y a trente-cinq hommes.
Aussitôt nous décidons de former une section dont Radelet prendra le commandement. Les quatre escouades seront commandées par les trois caporaux élèves sous-officiers et un soldat de première classe Lasire, l’ordonnance du sous-lieutenant d’Ornant. Quant à la question cuisine, nous renvoyons avec Chopin un cuisinier par escouade à Mesnil-les-Hurlus.
Ainsi, après avoir fait la répartition, nous avons en tout trente-cinq hommes, trois caporaux, un sergent, un sergent fourrier, un officier ; et au combat trente hommes, trois caporaux, vingt-et-un sous-officiers, un officier. C’est maigre, après avoir eu deux cent cinquante hommes, trois officiers, quatorze sous-officiers.
Chopin s’en va. Je le charge de dire des sottises à Jamesse et Delbarre, caporal fourrier est caporal d’ordinaire. Je demande que demain Jamesse remonte sur l’ordre du commandant de compagnie. Il n’est pas permis, après que sa compagnie n’a plus que des débris, de ne pas oser venir en tranchées voir les survivants, à plus forte raison sur un ordre. Ces messieurs se chauffent dans un gourbi* à Mesnil-les-Hurlus, mangent chaud ; je vais leur apprendre de quel bois je me chauffe. Pour quatre cuisiniers, un grade suffit amplement. Le caporal fourrier de ce fait remontera ici pour me remplacer.
Nous mangeons, Radelet et moi, avec le lieutenant Collandre qui est charmant. Officier de réserve à la 10e compagnie, il eut le crâne éraflé par une balle. Il a demandé à garder son commandement et vient de nous être envoyé pour reconstituer la 5e compagnie. Il m’apprend que le sous-lieutenant Gout a la 6e, le sous-lieutenant Carrière la 7e et le lieutenant Guichard la 8e.
Dans l’après-midi, je rentre au poste du commandant Vasson et avertis le capitaine Claire que la 5e est reconstituée. Le commandant m’annonce qu’il me cite à l’ordre du jour et me lit ma citation :
Lobbedey Émile, sergent fourrier à la 5e compagnie du 147e, agent de liaison du chef de bataillon, a fait preuve d’un courage remarquable depuis le début de la campagne et particulièrement dans la période de 28 février au 4 mars où il a porté, à de nombreuses reprises, des ordres sur un terrain des plus dangereux.
« Ainsi donc », me dit le commandant, « je vous prends toujours comme agent de liaison*, car nous ne sommes que le 2 mars. Soyez sans crainte, je ne vous exposerai pas inutilement ».
Je rentre dans l’abri de Pêcheur, tout heureux de l’estime de mes chefs. Je vais peu après communiquer un ordre au capitaine Werner du 3e bataillon, qui en a le commandement, plus la 3e compagnie. Je reprends le chemin de la veille de trous d’obus en trou d’obus car la tranchée est déchiquetée par le marmitage incessant. Je rencontre toujours le triste spectacle des cadavres qui gisent. Je longe ensuite la première ligne qu’occupe la 3e compagnie et j’atteins enfin le capitaine Werner qui se trouve à l’emplacement où fut blessé le capitaine Sénéchal. Il est là, revolver au poing, sous le bombardement, encourageant ses hommes par sa présence. Je lui demande quel commandement il exerce et quelle est la situation. Il me dit qu’il a le premier bataillon à sa gauche, commandé par le capitaine de la 1ère compagnie ; il commande le 3e bataillon et prend du point M au point N ; à sa droite, il a la 3e compagnie qui prend de N en O et lui rend compte.

Extrait Front de Champagne, 25 septembre 1915 – Source : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE F CARTE-9675
Je prends tous ses renseignements, accroupis tous deux au fond de la tranchée, tandis que les obus de canons revolvers, à chaque passage «ziiii i Boum », rasent le parapet et nous couvrent de terre. Je repars, au petit bonheur la chance, heureux d’arriver indemne au PC Vasson et de pouvoir rendre compte de ma mission.
J’éprouve grand amusement de voir la tête des poilus qui me demandent tous si je suis blessé en voyant ma capote déchirée à l’épaule.
De là, je file trouver le lieutenant Collandre, heureux de pouvoir lui annoncer la proposition de citation et l’avertissant que je suis à la disposition du commandant Vasson.
Je rejoins Pêcheur. Celui-ci m’annonce que le capitaine prend le commandement du 2e bataillon. Je suis horriblement fatigué. Pêcheur demande donc pour moi au capitaine Claire une nuit de repos, aussitôt accordée. Je file donc au PC du 2e bataillon où nous nous sommes placés en arrivant ici. Je trouve Gallois et toute la bande occupés à manger. J’installe mon fourniment dans une petite grotte et roulé dans mes couvertures, je m’endors sans manger. Je n’en puis plus.
Départ de Dampierre
À 4 heures, nous sommes réveillés par des appels. C’est Brillant qui nous crie alerte, départ à 6 heures. Nous lisons la note qu’il nous apporte à la lueur d’une bougie. Aussitôt Lannoy monte chez le capitaine, tandis que Jamesse et moi, nous occupons à placer la comptabilité dans le coffre de la voiture.
Lannoy descend avec les ordres pour la compagnie : rassemblement à 5 heures 40 devant le cantonnement de la compagnie. Rogery part communiquer les ordres aux quatre chefs de section.
Nous bouclons notre fourniment. Et quand le capitaine descend, nous lui rendons compte que nous sommes prêts.
À 6 heures, nous partons par un temps brumeux qui nous fait présager un beau soleil pour 10 heures.
Je m’attache à la liaison du bataillon qui passe. C’est un vrai état-major. Il y a là Gallois, adjudant de bataillon, Legueil, Sauvage, Jombart et moi, sergents fourriers des 6, 7, 8 et 5e compagnies, Verleene et Paradis, caporaux fourriers des 6e et 8e compagnies, René, agent mitrailleur, Gauthier, clairon cuisinier, Jacques, maréchal des logis de liaison, Brillant, Frappé, Garnier, agents de liaison des 5, 7, 8e et celui de la 6e. Cela fait en tout quatorze hommes. Les 6e et 8e ont même ici en excédent leurs caporaux fourriers. Si avec cela les ordres ne sont pas bien communiqués, je n’y comprends rien.
Nous partons dans la direction de la route Châlons-sur-Marne à Sainte-Menehould. Après une pause, nous y tombons et rencontrons les deux autres bataillons qui nous attendent. Nous nous encastrons entre le 1er et le 3e et continuons, parmi le mouvement des autobus, des automobiles et des convois. La route est large, spacieuse et peu boueuse ; mais il y règne une circulation intense.
Nous ne tardons pas à quitter cette route et prenons la route de Valmy à droite. Nous avons à notre gauche le champ de bataille de Valmy et apercevons au loin le monument de Dumouriez qui surplombe la plaine.
Il peut être 9 heures quand nous passons la voie ferrée filant sur Somme-Bionne. Une bonne pause nous permet de juger du trafic qui se fait en gare de Valmy ; c’est quelque chose de fantastique.
Je vois passer sur la route un convoi automobile tandis que nous stationnons dans un champ à droite. J’aperçois la voiture camion automobile de la « Droguerie rouge, Dunkerque », ce m’est une étrange sensation et il me semble que c’est un coin du pays que je viens de voir.
Un coup de sifflet, nous repartons. Je commence à sentir un peu de fatigue : la route est longue. Le temps est beau, le soleil nous sourit.
On commence à sentir qu’on approche du front. Nous approchons de Somme-Bionne et voyons quelques cagnas* d’artilleurs, des cuisines en plein air. Nous voyons des « saucisses », ballons observatoires, tout à côté de la route et nous regardons curieusement. Tout cela nous dit que ça sent la tranchée. D’ailleurs nous entendons distinctement le canon qui tonne.
Nous passons dans Somme-Bionne. Le village, sans être démoli, semble dévasté par le passage des troupes. Beaucoup d’habitations sont dans un état lamentable : beaucoup sont abandonnées. Beaucoup de portes, de carreaux manquent. À l’intérieur, on voit des hommes qui font la cuisine, d’autres qui sont couchés sur la paille. Dans la rue, c’est un va-et-vient de convois de ravitaillement.
Les routes sont boueuses. Des troupes sont cantonnées ici et nous regardent défiler. Vers le milieu du village, nous apercevons, rassemblés dans la cour d’entrée d’une maison, une centaine de prisonniers boches, tout couverts de boue et minables dans leur aspect.
À la sortie du village, je suis pris par le bras. Je me retourne et me trouve face à face avec un soldat de mon pays, Ravel, que je connais bien : il habite à 400 m de ma demeure. Nous causons comme on se cause, en guerre, après deux ans de séparation et en marche quand on se rencontre. Je suis tout heureux de voir pour la première fois depuis les hostilités une tête connue avant la guerre. Nous causons beaucoup du pays, on cesse une conversation à peine ébauchée pour en prendre une autre. Il me quitte après un parcours de 500 m, me disant qu’il est boucher au ravitaillement du régiment, le 8e d’infanterie.
Extrait de la carte d’état-major – Source : Géoportail
À 600 m de Somme-Bionne, nous faisons une grand’halte, dans une prairie située à droite de la route. Il est midi.
Aussitôt les feux s’allument et les escouades font cuire leur frite [ ?], arrosée d’un bon quart de « jus ».
Pendant la pause, des aéroplanes nous survolent.

De nombreux convois passent, artillerie et infanterie. La route se sèche par ce beau soleil et déjà il y a de la poussière. En un mot, c’est l’activité fébrile de la proximité des lignes, l’arrière tout proche à 10 ou 12 km du front.
Une heure après, devançant le régiment d’une demi-heure, nous partions, Gallois, les trois fourriers et moi. À 400 m, nous nous unissons au campement des deux autres bataillons et bon [ ?] pas sous les ordres de trois officiers, un par bataillon, nous arrivons dans un pays de ruines où tout est rasé, à part quelque maisons restaurées avec des moyens de fortune et l’église à peu près intacte. C’est Somme-Tourbe. Nous avons la voie ferrée à notre gauche et un train passe direction [de] Paris : il nous fait gros cœur.
La vue du village, qui me rappelle mes souvenirs de la Marne, me fait pitié. Nous marchons toujours sans arrêt, afin de distancer la colonne du régiment. Nous tournons à droite, prenant la route de Saint-Jean-sur-Tourbe. Je suis fatigué par cette marche rapide. De plus, le soleil exagère car il nous envoie des rayons trop chauds. Après un parcours de 1500 m, nous prenons à travers champs, nous dirigeant vers des baraquements en planches situés à 200 m à gauche de la route.
Les officiers partent à cheval à travers les terres, nous disant de les attendre ici.
Heureux sommes-nous de pouvoir enlever nos sacs !
Nous avons tout loisir d’examiner les installations. Elles sont des plus rudimentaires. Si c’est là notre logement, ce n’est pas fameux. Les planches sont disjointes ; donc s’il fait mauvais temps, il pleut à l’intérieur ; quant au froid, aux courants d’air, la nuit surtout, inutile d’insister. L’intérieur n’est autre que l’extérieur avec des piquets soutenant le toit. Le baraquement se continue sans cloison sur 300 m. De quoi loger deux compagnies, à moins qu’on se serre. Je crois que nous serons malheureux là-dedans. Comme sol, la terre.
Je sors. Mon examen m’a suffisamment renseigné. Non loin de là se trouve un amas de claies près duquel je vois un homme portant l’écusson du 8e d’infanterie. Aussitôt, je lui demande si le 1er corps est de ces côtés. Il ne sait ; du moins le 110e et le 8e sont de quelques jours en tranchées. Il est à l’arrière au train de combat, dans un bois qu’il me montre là-haut. Je lui cite des noms, lui demande des nouvelles d’amis du pays, il ne m’apprend rien de particulier sinon ce que je sais déjà de Ravel : capitaine Brouet tué, le lieutenant Blasin passé capitaine tué, sergent Kind, sergent Crandalle, adjudant Vandenbosshe tués, etc…
Nos officiers reviennent au galop. Je file au rassemblement, heureux d’avoir vu l’écusson du 8e. Nous partons 200 m plus loin. Là, j’hérite d’un baraquement semblable à ceux que je viens de quitter. Il y en a plusieurs : un pour deux compagnies. Nous commençons aussitôt le cantonnement des plus faciles. Je réserve une partie aux officiers. Une partie est dévolue à la liaison du bataillon. Puis on partage en deux. Je réserve un coin près de la liaison du bataillon pour le bureau de la 5e compagnie. Il n’y a plus qu’à attendre l’arrivée des troupes.
Le baraquement me fait tout l’air d’un dortoir. Il a 300 m de long sur 3,50 de large. Je vois d’ici la tête des troupes et des officiers. Tous les 25 m, il y a une ouverture. Avec les planches disjointes, je l’entends déjà baptisé : Hôtel des courants d’air.
Il peut être 3 heures. Le colonel Blondin, à cheval, commandant la brigade, avec le capitaine Garde, de son état-major, vient visiter les lieux. J’ignore ce qu’il pense du logement des troupes.
Enfin, voici le bataillon. Quand on aperçoit le logis, chacun fait grise mine et j’entends le sous-lieutenant Vals proférer « Où est mon gourrrrrbi de la Gruerie ? ».
Une heure après, le troupier était déjà occupé à arranger le tout de son mieux avec ses moyens de fortune : claies pour le sol, toile de tente pour le toit, couverture pour boucher les entrées, etc…, tandis que les cuisiniers, selon les ordres, à 100 m commençaient leurs feux et que des corvées creusaient des feuillées [1] à 250 m.
Je m’installe non loin des officiers avec la liaison du bataillon et le bureau de la compagnie que je vais quitter car nous ne tarderons pas à rejoindre les tranchées. Les cuisiniers des officiers sont occupés à installer une table avec des moyens de fortune et à aménager tant bien que mal, plutôt mal que bien, le coin de nos chefs.
Nous décidons de cesser pour l’instant toute popote entre Culine et la bande, le souvenir des bons moments passés restera chez nous d’une façon impérissable, en attendant des moments meilleurs où nous pourrons recommencer.
Un cuisinier de la compagnie, Lavoine, se charge de la nourriture de Culine et Lannoy. Levers et Delacensellerie rentrent dans leur escouade. Je me remets donc avec la liaison du bataillon et mange la bonne cuisine de Gauthier.
Le soir tombe. Roulés dans nos couvertures, nous nous remettons aux bras de Morphée, lui demandant de chauffer les courants d’air et de chasser les nuages.
[1] feuillées : Latrines de campagne, généralement creusées dans la terre un peu à l’écart des tranchées principales. Les soldats s’y rendent pour « poser culotte », selon l’expression employée alors.